La ville d’Éphèse
| L’occupation humaine du site de la future Éphèse
remonte à -5000 ans. On a retrouvé des fragments de céramique et
d’obsidienne. Le premier grand établissement d’une population remonte à
-1800 ans, l’âge de bronze. En -1600, on y trouve une colonie mycénienne
dont on a retrouvé une tombe et un mur de gros blocs de pierre. Le
royaume le plus puissant de l’époque fut l’Arzawa dont la capitale,
Apasa, a peut-être donné Ephesos. Plus tard, les régions de l’Anatolie
furent dominées par les Hittites. L’Eurasie, au XIème siècle avant JC
était très agitée et connaissait un grand brassage de populations,
notamment les Ioniens. Éphèse était l’antique capitale de l’Ionie. La
tradition grecque attribue la fondation d’Éphèse à Androclos (fils du
roi Codros). Le site était occupé par des peuples Lélèges et
Cariens
(peuples d’Anatolie) et les Ioniens se heurtèrent au culte de la
déesse-mère Cybèle. Plus tard, les Grecs optèrent pour le syncrétisme et
fusionnèrent son culte avec celui d’Artémis. C’est la
Diane des Latins. La cité d’Éphèse fut gouvernée par des rois, puis par une oligarchie
aristocratique puis par des tyrans. |
 |
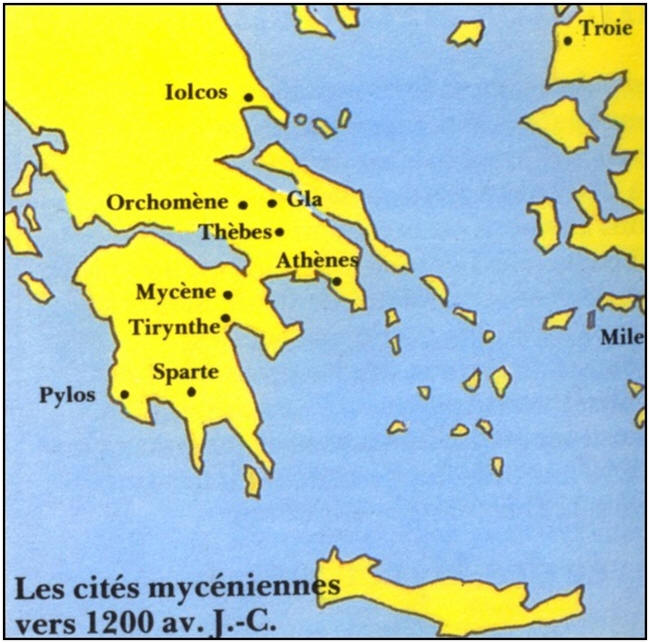 -675 conquise par les Cimériens
(Scythes venus des steppes) qui détruisirent le premier autel dédié à
Artémis en punition de leur résistance.
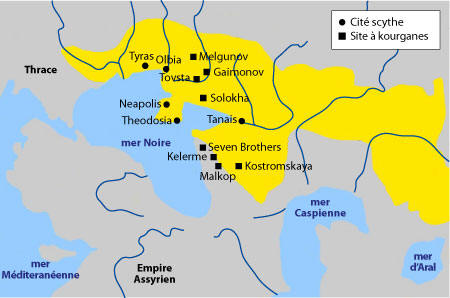 -Le -VIIème siècle connut
l’essor de l’activité portuaire avec l’apparition de taxes portuaires
mises en place au début du -VIème siècle. La cité s’enrichissait
considérablement. En -570, les Samiens (île de Samos) construisirent
un temple monumental qui rendit la ville d’Éphèse jalouse. Les Éphésiens
décidèrent donc de construire un temple monumental. Ils firent revenir
des architectes de Crète. C’est à cette époque que la ville d’Éphèse
devint un grand foyer culturel et un centre intellectuel et artistique
de tout premier plan dans le bassin méditerranéen. On y trouvait des
écoles de médecine, de rhétorique, de philosophie. La ville s’agrandit
vers l’est. On n’y construisit un stade, un gymnase, un théâtre. En
-561, la ville passa sous le contrôle du royaume de Lydie et de son roi
Crésus. C’est lui qui finança la construction des 100 colonnes du temple
d’Artémis. En -547 à la bataille de Ptérie, Crésus fut défait et la cité
passa sous la domination des Perses. Les Perses respectèrent la ville et
ne tentèrent pas de détruire sa culture ni ses édifices. Elle
traversa ensuite les guerres médiques, les guerres du Péloponnèse. Elle
se rallia à Athènes contre Spartes puis se révolta contre elle (-412).
Elle passa de nouveau sous tutelle perse puis sous Alexandre Le Grand
qui proposa de participer aux frais de reconstruction de l’Artémision
brûlé pendant la guerre en -356. Les Éphésiens refusèrent. Au IIIème
siècle, Éphèse devint un centre administratif important. La ville se
dota d’une enceinte encore visible aujourd’hui. Elles comptaient 100 000
habitants et son théâtre pouvait accueillir 24 000 spectateurs. Elle
passa sous les Séleucides, des Lagides, des Séleucides à nouveau, des
Attalides (rois de Pergame) alliés aux Romains. Au cours du Ier siècle
avant JC, l’Empire Romain a incorporé l’Asie Mineure. La ville
d’Éphèse était considérée comme la plus grande et la plus sophistiquée
des villes Asie Mineure. Elle avait une architecture très élaborée,
décorée avec goût et fameuse pour ses nombreux temples païens, ces
écoles de philosophie et ses universités, ses gymnases, sa cour de
justice, ses spectacles théâtraux et les jeux de son stade. Éphèse était
réputée également pour ses nombreux citoyens nobles comprenant le
proconsul de Rome qui en avait fait sa résidence. Il était protégé par
la Garde Prétorienne, l’élite des légionnaires romains. La ville
d’Éphèse, du temps de Paul, jouissait du statut de ville libre et
s’administrait elle-même par son assemblée de notables et du peuple et
par son président le prytane. Le secrétaire était l’équivalent du maire
d’aujourd’hui. Les deux activités principales de la ville étaient
l’activité portuaire et le tourisme. Qui dit marins et touristes dit
également développement de toutes sortes de vices. La prostitution à
Éphèse était une activité florissante. Il y avait un grand bordel
central et de nombreux autres petits établissements indépendants. En
arrivant au port, et en montant vers l’agora, le voyageur pouvait noter
sur le sol, des silhouettes de pas gravés avec un visage de femme à
côté. En suivant les traces de pas, le visiteur était conduit
directement dans le lupanar en question. On pratiquait aussi la
prostitution sacrée dans le Temple : les prostituées, surnommées en
latin melissae, représentaient la déesse avec laquelle les clients
venaient s’unir charnellement et mystiquement. Géographie
Située sur la côte occidentale de l’Asie Mineure, à 5 km de
l’embouchure du Caystre, Éphèse se trouvait à la jonction des
voies commerciales naturelles menant de l’Occident à L’Orient.
On la surnommait « la passerelle » entre l’Est et l’Ouest. Grâce
à son climat doux et à son sol fertile, on y cultivait des
céréales, des arbres fruitiers, des oliviers, on y élevait des
chevaux. Au IIIème siècle avant notre ère, les docks avaient été
élargis au point que 100 gros bateaux pouvaient s’y ancrer en
même temps. Le port d’Éphèse était connu comme étant le plus
prospère des ports de l’Empire Romain. On y débarquait
quotidiennement des milliers de marchandises : des sacs, des
amphores, des caisses, des coffres, des vases, des aromates,
etc. De toutes les parties de l’empire : Rome, Crète, Palestine,
Carthage, Espagne, Alexandrie, Grèce, etc. Chaque armateur
identifiait sa marchandise en la marquant par un scellé portant
son nom et sa marque. C’est sans doute pour cette raison que
l’apôtre Paul fait allusion au fait que les croyants sont «
scellés du Saint Esprit » pour les reconnaître parmi le
Monde.
Par ailleurs, les larges routes pavées reliant Éphèse à d’autres
villes d’Asie Mineure ont permis la diffusion de ces
marchandises facilement mais aussi des idées et des croyances.
Malheureusement, année après année, les alluvions ont
complètement ensablé le port. Au temps de Paul, le port
n’était plus relié à la mer que par un canal que les gros
bateaux ne pouvaient plus emprunter et qu’il fallait nettoyer
régulièrement. Cet envasement progressif de l’embouchure a fini
par étouffer le port et a ruiné la ville, associé au paludisme
et à un tremblement de terre. Les vestiges se trouvent
actuellement à une dizaine de kilomètres de la mer. La ville
d’Éphèse occupait une grande surface et comptait entre 300 et
400 000 habitants, dont un quart d’esclaves. Bien que Pergame,
l’ancienne capitale du royaume de Lydie, soit restée la capitale
administrative, Éphèse était la première ville de la province
d’Asie, par laquelle arrivaient tous les visiteurs venus de
l’Occident. Elle était le plus grand centre commercial et c’est
sans doute dans le port d’Éphèse que l’apôtre Jean a vu passer
les marchandises qu’il énumère dans Apocalypse chapitres 18.12-13 et
qui étaient destinées à Babylone. Les ports d’Éphèse, d’Antioche
et d’Alexandrie étaient les trois sommets du triangle commercial
de la Méditerranée orientale. Éphèse était, surtout, la capitale
religieuse de l’Asie Mineure. L’Artemision
 |
On y
trouvait le célèbre temple d’Artémis, qui s’appelle
Diane chez
les Romains, point de ralliement d’un culte florissant. Détruit
dans un incendie en 356 avant Jésus-Christ, il fut reconstruit
en marbre blanc sur une plate-forme de 127m sur 72m, à laquelle
on accédait par 12 marches. C’est quatre fois plus grand que le
Parthénon d’Athènes. Ils comptaient 100 colonnes monolithiques
en marbre de 16m de haut. Il a été compté parmi les sept
merveilles du monde. L’intérieur du sanctuaire était orné de
sculptures et de peintures de Phidias, de
Praxitèle, de Scopas,
de Parrhasios, Apelle et, en particulier, de la statue de la
déesse que l’on disait tombée du ciel, peut-être parce qu’elle
avait été sculptée dans une météorite. La renommée de la Diane
d’Éphèse dans le bassin méditerranéen est attestée par
la présence de monnaie d’argent en provenance de très
nombreux pays que l’on a retrouvé sur le site. |
Sur la statue de Diane on a
retrouvé des formules utilisées comme incantations magiques :
astrologie, sorcellerie, exorcisme, confection d’amulette étaient
liés au culte d’Artémis. Les orfèvres qui fabriquaient des
temples miniatures constituaient une corporation nombreuse et
très puissante. Le culte de l’empereur fut progressivement
associé à celui de Diane : des inscriptions et des médailles
nous révèlent que la ville s’enorgueillissait d’être la
gardienne du temple d’Artémis et des empereurs. Rien ne
pouvait avoir réellement préparé l’apôtre Paul au choc culturel
de la ville d’Éphèse. Paul, anciennement Saul, était originaire
de la ville de Tarse où il avait suivi des cours à l’université.
Cette ville était riche et sophistiquée, à son échelle. Mais
quand Paul, Priscille et
Aquilas ont débarqué à Éphèse, ils ont
dû se sentir totalement submergés dans leurs sens physiques,
dans leur esprit, par le gigantisme de la ville mais aussi par
l’ampleur de la mission apostolique qui les attendait. On y
trouvait de nombreuses nationalités, cultures et langues. Latin,
araméen, hébreu, grec, égyptien, pour n’en citer que
quelques-unes. C’est comme si Paul et ses compagnons avaient mis
le pied dans un monde miniature. Généralités
sur l'épître Écrite entre
60 et 64, l’épître aux Éphésiens a été appelée le « testament
spirituel de l’Église ». Elle dresse un panorama grandiose du
plan de Dieu pour l’Humanité, depuis l’Éternité avant la
Création jusqu’à l’Éternité qui suivra la fin de toute
l’Histoire humaine, en passant par les applications dans la vie
quotidienne des croyants. Cette épître est également
considérée comme l’aboutissement de la pensée de Paul présentée
dans les épîtres antérieures. Elle présente également une grande
unité interne et très peu de références à la situation
particulière d’une église locale ce qui rend sa portée
universelle. Bien qu’elle présente de nombreuses similarités
avec l’épître aux Romains, l’épître aux Éphésiens traite des
mêmes sujets non pas sous l’angle individuel du salut mais
sous
le plan corporel de l’église, Corps de Christ. On sait qu’elle a
été rédigée en même temps que l'épître aux Colossiens, église menacée par
l’influence du gnosticisme. Sur 115 versets d’Éphésiens, 73 ont
un parallèle dans Colossiens et 1/3 des mots de Colossiens se
retrouvent dans Éphésiens. C’est également
une épître
trinitaire, dans la mesure où l’apôtre fait continuellement
référence à la triunité de Dieu comme modèle pour les relations
au sein du Corps de Christ. Prenons comme exemple le premier
verset :
« béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes bénédictions
spirituelles dans les lieux célestes en Christ ».
Vous trouvez là le Père, le Fils et le Saint Esprit. Bien que cette lettre ait été destinée à plusieurs églises, il est normal, à cause de la position d’Éphèse comme capitale de l’Asie, que Paul ait
pensé à elle en priorité comme destinataire de l’épître. Une fois reçues par une église, les lettres étaient souvent recopiées et réexpédiées vers d’autres églises après avoir
retiré de l’en-tête les destinataires initiaux mais sans oser les remplacer par de nouveaux. Ce qui explique que plusieurs manuscrits de cette épître ne fassent pas apparaître dans
l’introduction les Éphésiens comme destinataires. Lorsque Tychique a débarqué à Éphèse il a dû rencontrer des frères et
leur lire la lettre de l’apôtre Paul. Ces derniers en ont
peut-être fait une copie. À cause du prestige de la vie
d’Éphèse, il est normal que cette épître soit connue comme
l’épître aux Éphésiens. Malgré cela, il se peut que Paul ait
davantage pensé à tous les chrétiens qu’il ne connaissait pas
personnellement plutôt qu’à ceux qu’il connaissait à Éphèse.
Marcion a trouvé un manuscrit où figuraient les mots «
qui sont
à Laodicée ». Ainsi, d’après certains chercheurs, l’épître aux
Éphésiens serait cette mystérieuse épître aux Laodicéens que
l’on croyait perdue et dont Paul recommande la lecture aux
Colossiens (4.6) : « Quand cette lettre aura été lue chez
vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des
Laodicéens, et que vous, vous lisiez également celle qui vous
arrivera de Laodicée. ». Grâce aux formes grammaticales et
aux variations de la tradition manuscrite nous pouvons conclure
que :
- La lettre n’était certainement pas destinée à la
seule église d’Éphèse ;
- La majorité des lecteurs n’était
pas nés de nouveau par le ministère de Paul (1.15 ; 3.2-7 ;4.21)
;
- Cette épître est probablement celle que les Colossiens
devaient recevoir de Laodicée, ce qui implique qu’elle avait un
caractère de circulaire ;
- Elle est adressée un groupe
délimité de chrétiens ou d’églises dont Paul a pu recevoir des
nouvelles et que Tychique a pu visiter ;
- Le parallélisme de
la dernière formule avec Colossiens 4.7,8 indique que les
destinataires se trouvaient dans la province d’Asie.
Le fond de l’épître L’épître aux Éphésiens est considérée
comme l’écrit le plus difficile de Paul, le plus profond, le
plus théologique aussi. Tout est centré sur Dieu lui-même, sur
sa volonté, sur son dessein éternel. On sent que les 4 années de
prison lui ont permis d’approfondir sa pensée et de pousser sa
réflexion au-delà des limites que lui imposait la vie active.
Même le vocabulaire s’en ressent : on y trouve 80 mots nouveaux
par rapport aux épîtres antérieures dont une bonne trentaine ne se
retrouve dans aucun autre livre du Nouveau Testament. Il n’y est
pas fait référence à des situations précises de la vie d’une
église locale. Il n’y a aucune salutation, comme dans l’épître
aux Galates, aucun reproche n’est adressé à la communauté, aucun
détail ne permet de la situer à un moment précis de la vie de
Paul. Le thème central est l’Église, Corps de Christ, dont il
parle 8 fois, et qui est vue sous l’aspect universel ; c’est
l’Église de Matthieu 16.8 que Jésus-Christ bâtit Lui-même.
C’est la nouvelle Humanité constituée de la fusion de deux blocs
jusqu’alors antagonistes : Juifs et Païens. C’est la famille de
Dieu dans laquelle toutes les barrières ont été abolies. C’est
l’épître qui présente l’union spirituelle totale avec le Christ
exprimée par le mot « en » qui apparaît 120 fois dans l’épître :
c’est le plus petit mot (avec deux lettres) mais c’est le plus
grand par son sens. C’est l’épître qui montre également
l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. À chaque
présentation dogmatique du Saint-Esprit, correspond une
responsabilité pratique dans la vie du croyant.
Le but de l’épître Elle est à but
didactique. Devaient se
trouver à Éphèse beaucoup de jeunes convertis issus du paganisme
qui ne connaissaient pas les fondements de la foi ni comment il
fallait se conduire dans la vie chrétienne. Par ailleurs, Éphèse
était un centre intellectuel et un lieu de passage/de brassage
où transitaient beaucoup d’idées et de spéculations
philosophiques. Paul avait averti les anciens d’Éphèse que se
lèveraient « des hommes qui enseigneraient des choses
pernicieuses pour entraîner des disciples après eux » (Actes
20.30). À cause aussi de l’extension du ministère de Paul auprès
d’autres églises (Laodicée, Colosses, Smyrne, Pergame, Thyatire,
Sardes, Philadelphie), dont beaucoup n’avaient pas vu son
visage, l’apôtre était en souci de maintenir la pureté de la
doctrine loin de la corruption de ce genre d’hommes, qui ne
manqueraient pas de décrier l’apôtre et son enseignement dans
son dos. Les nouvelles données par Epaphras au sujet « des loups
cruels » sont alarmantes et, peut-être, ont-elles été le
déclencheur de l’épître aux Éphésiens. À cause aussi de l’issue
incertaine de son procès et sachant qu’il peut disparaître à
tout moment, l’apôtre sent le devoir impérieux de consigner par
écrit un texte de référence, posant des fondements stables, et
synthétisant ses enseignements antérieurs. Il sent que les
églises issues du paganisme sont faibles et vulnérables : il
veut les affermir. Il souhaite les hisser à la hauteur de la
vocation céleste qui leur est adressée. L’église d’Éphèse
Par qui l’Évangile est-il arrivé à Éphèse ? Des Juifs d’Asie
étaient présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte comme Luc
le rapporte dans le livre des Actes 2.10. On peut donc imaginer
que le salut soit entré par ces juifs d’Asie revenus dans la
synagogue d’Éphèse. Les juifs étaient nombreux dans cette ville
commerçante et entretenait des relations suivies avec
Jérusalem. À la fin de son deuxième voyage, l’apôtre Paul avait
laissé à Éphèse Aquilas et Priscille qui continuaient à se
rendre à la synagogue locale. Ils y rencontrèrent après Apollos.
Peut-être y avait-il déjà une petite église de maison puisqu’il
est dit que « les frères » encourageaient Apollos à se rendre en
Achaïe et qu’ils écrivaient aux disciples de Corinthe de bien
les recevoir. Lors de son troisième voyage missionnaire,
l’apôtre Paul fréquenta la synagogue pendant trois mois,
s’efforçant de persuader les juifs que Jésus était le Messie.
Confronté à l’incrédulité persistance de certains d’entre eux,
il décida de séparer les disciples et de constituer l’église en
dehors de la synagogue dans l’école du philosophe Tyranus.
Croissance de l’Église Paul a passé trois ans à Éphèse.
L’apôtre a prolongé son séjour dans cette ville car il a senti
toute l’importance stratégique qu’elle représentait pour
l’expansion de l’Évangile en Asie Mineure. Luc divise cette
période en trois parties :
- Trois mois passés dans la
synagogue ;
- Deux ans dans l’école de Tyranus ;
- Enfin,
la période de réveil (9 mois) qui s’inscrivit dans un grand
combat contre l’occultisme asiate. L’épisode des fils de Sceva a
constitué le point de départ de ce réveil.
On voit que
l’Évangile a touché tous les milieux et toutes les couches
sociales. Il a suffi des signes et des prodiges pour que
l’attention d’une ville entière se tourne vers l’apôtre. Un
indice du succès colossal de l’évangélisation nous est donné par
l’autodafé de nombreuses personnes qui sont venues brûler leurs
livres d’art magique et de sorcellerie. (Au passage, vérifiez
bien dans vos maisons qu’il ne traîne pas quelque objet de
nature occulte héritée de votre vie passée : des pendules, des
statuettes, des livres d’astrologie, etc.) La somme de 50 000
pièces d’argent constituait à l’époque une fortune colossale.
Cet épisode ne passa certainement pas inaperçu. La
conséquence directe de ce réveil et de cette victoire sur
l’Occultisme à Éphèse, fut la baisse d’activité des artisans
orfèvres. Oui, l’évangélisation peut avoir des répercussions sur
la vie économique de notre pays. Imaginez un réveil massif en
France, vous verriez les sex-shops, les bars, le trafic de
drogue, les librairies occultes et ésotériques, les cabinets de
voyance, de médium, disparaître. C’est ce qui s’est produit
lors du réveil du pays de Galles au XIXème siècle : les bars, les
stades de football, les lieux de prostitution, fermèrent les uns
après les autres. On raconte que, dans les mines de charbon, les
mineurs convertis ne parvenaient plus à faire avancer les mules
qui ne comprenaient que les gros mots et les insultes que les
mineurs, devenus chrétiens, refusaient à présent de prononcer.
Composition de l’église L’Église d’Éphèse était constituée
essentiellement de païens convertis qui s’étaient regroupés
autour d’un noyau judéo-chrétien primitif. Après le départ de
Paul, l’église continua sous la direction de ses anciens. Paul
leur annonça par avance que des difficultés surgiraient au sein
de l’église parce que des hommes enseigneraient « des choses
pernicieuses pour entraîner des disciples après eux » (Actes
20.29,30) C’est ce qui s’est produit et Paul a dû retourner à
Éphèse après son premier emprisonnement à Rome. Il laissa
Timothée pour lutter contre les faux docteurs et pour ramener
dans le droit chemin les chrétiens qu’il avait quittés. L’église
d’Éphèse a joué longtemps le rôle d’église-mère de la province.
Paul demeura plus longtemps à Éphèse que dans aucune autre
ville. Après son départ, une église reconnue et structurée avec
des anciens continue de se développer. Les ministères de
Timothée et de l’apôtre Jean continueront d’affermir l’œuvre
après lui. Au premier siècle, certains historiens évaluent à
près de 60 % la population de chrétiens dans
les grandes villes et à 80 % de païens dans les campagnes.
Conclusion Par son caractère universel, l’épître aux
Éphésiens s’adresse directement à nous aujourd’hui. Elle doit
nous amener à marquer une pause et à nous examiner sérieusement
:
- Ai-je vraiment compris la grandeur de l’Évangile ?
- Ai-je bien saisi la portée de mon appel ?
- Ai-je bien mesuré
les implications et les exigences de la vie de disciple ?
- Finalement, ai-je bien compris qui je suis en Christ ? Quelle
est mon identité en Christ ?
 Haut de page
Sommaire des publication de Th.
Cazeneuve
|